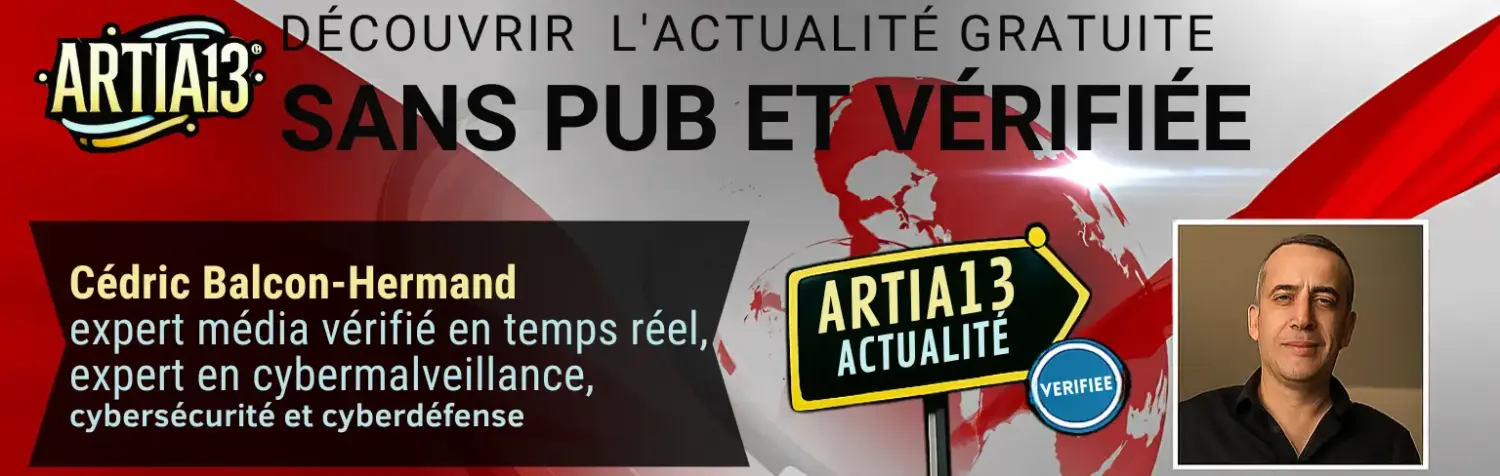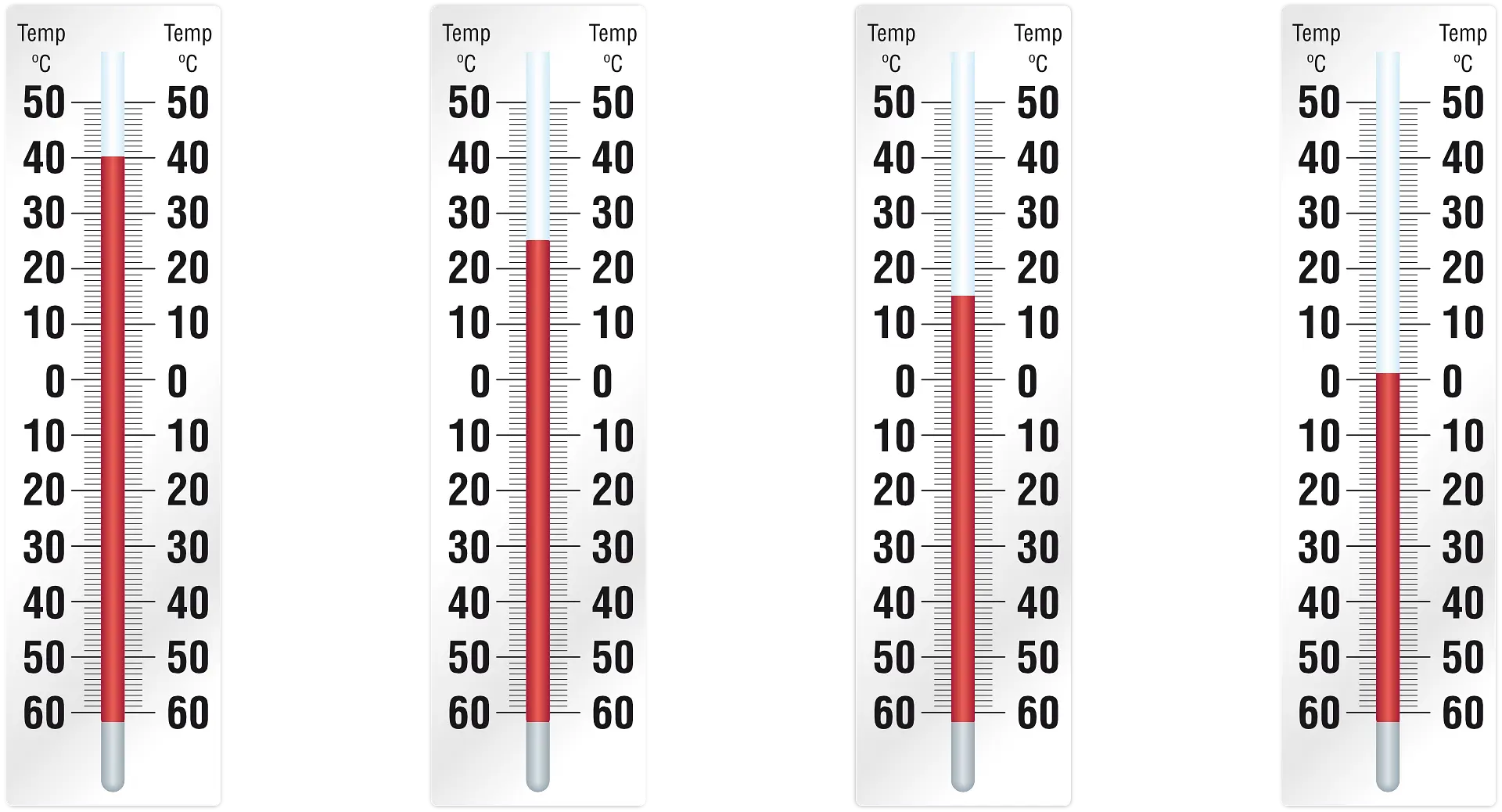Évaluation des Failles dans l’Intégrité Scientifique : Que Révèle le Nouveau Rapport ?
Un nouvel état des lieux des méconduites scientifiques en France met en lumière les tensions croissantes entre chercheurs, aggravées par une compétition accrue. Ce rapport soulève des questions quant à l’efficacité de la mesure de la fraude scientifique.
Le premier état des lieux français des méconduites scientifiques montre le poids considérable des conflits entre chercheurs. Lesquels sont rendus inévitables par l’accentuation de la compétition entre eux. Mais la fraude scientifique est-elle vraiment mesurée ?
* * *
I
Il y a tout juste dix ans, les accusations de fraude scientifique à l’encontre du biologiste Olivier Voinnet avaient profondément secoué le monde de la biologie en France. Exclu du CNRS pour deux ans sans explication officielle, il a vu huit de ses articles rétractés suite à des manipulations inappropriées.
Ces événements ont ouvert la voie à d’autres accusations, notamment contre la directrice du département de biologie du CNRS, Catherine Jessus, et la présidente par intérim du CNRS, Anne Peyroche. Leurs sanctions ont été jugées moins sévères que celles infligées à Voinnet.
En réaction à ces scandales, l’État a missionné Pierre Corvol, un reconnu administrateur du Collège de France, pour élaborer un rapport en 2016. Ce dernier a servi de fondement à la réforme des pratiques de gestion des manquements à l’intégrité scientifique.
UN THERMOMÈTRE DES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RECHERCHE
Depuis le rapport Corvol, des mesures concrètes ont été instituées. L’intégrité scientifique est désormais définie par la loi comme l’assurance du « caractère honnête et scientifiquement rigoureux » des recherches, ce qui laisse chaque discipline adapter cette définition. Tous les organismes de recherche ont désigné un référent chargé d’examiner toute accusation de manquement.
130 manquements à l’intégrité scientifique dans la recherche française en 2022 et 2023.
Récemment, l’Office français de l’intégrité scientifique (Ofis) a été mis en place pour assurer une approche harmonisée des politiques d’intégrité. Leurs recommandations, publiées le 21 juillet, visent à « renforcer l’équité et la transparence » lors du signalement des manquements.
Le 28 mai, l’Ofis a présenté son premier rapport sur le traitement des manquements, que l’on espère devenir une référence pour évaluer les dysfonctionnements dans la recherche.
Pour 2022 et 2023, le rapport fait état d’au moins 130 manquements à l’intégrité scientifique, une estimation qui pourrait être sous-évaluée, à cause d’une réponse incomplète d’un tiers des établissements. Néanmoins, plusieurs grandes institutions ont fourni des données.
La biologie, la médecine, et les sciences humaines et sociales en tête.
Les domaines les plus touchés comprennent la biologie et la médecine (55 cas) ainsi que les sciences humaines et sociales (32 cas), tandis que la physique et les mathématiques arrivent très loin derrière (4 et 2 cas respectivement). Les manquements se divisent entre :
- Conflits d’auteurs pour la signature d’article (40 cas)
- Plagiats (32 cas)
- Falsifications de résultats (18 cas)
- Mauvaise gestion des données (11 cas)
- Violations éthiques (6 cas)
- Non déclaration de conflits d’intérêt (6 cas)
- Fabrication de données (1 cas)
- Situations variées (11 cas)
FRAUDE ET PLAGIAT, MÊME COMBAT ?
Ce recensement illustre l’approche européenne des méconduites scientifiques. Contrairement aux États-Unis, où la fraude se limite aux cas de falsification et plagiat, l’Europe prend en compte une multitude de comportements qualifiés de pratiques de recherche questionnables.
Le plus souvent, la fraude authentique coexiste avec d’innombrables autres atteintes à l’éthique scientifique.
Le cas de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille dirigé par Didier Raoult confirme que les fraudes et autres atteintes ont tendance à se chevaucher. Si les essais cliniques illégaux sont préoccupants, en quoi les conflits de signature et le plagiat, qui constituent deux tiers des cas, sont-ils menaçants ?
Au-delà des faits, les critères pour l’ordre de signature d’un article demeurent obscurs. Lorsqu’un article a plusieurs signataires, qui doit se retrouver en premier ? Généralement, le premier est celui qui a réalisé une part significative du travail, ce qui peut causer confusion et tension.
L’impensé de tout cela est la question de l’individualisation dans la recherche, les chercheurs étant engagés dans une folle compétition entre eux.
Ces dynamiques impactent les carrières des chercheurs, car les candidatures et les promotions sont souvent basées sur la perception de chaque chercheur au sein d’une équipe de recherche collective.
LE PLAGIAT, UNE MENACE POUR LES RELATIONS SCIENCES-SOCIÉTÉ ?
Les enjeux autour du plagiat ont également emprunté un parcours compliqué, avec la montée de logiciels de détection et des entreprises spécialisées. Bien que des mesures soient prises pour educate les futurs chercheurs, se pose la question de l’efficacité des outils actuels pour adresser la fraude scientifique.
Si une idée vraie, remarquablement formulée, est recopiée ad libitum, en quoi est-ce préjudiciable au savoir ?
Il existe une crainte que le plagiat compromette la confiance du public dans la science. Mais si des idées précises sont reproduites fidèlement, cela est-il nécessairement nuisible ? Historiquement, être plagié a été perçu comme un signe d’honneur, alors pourquoi cette perception a-t-elle changé ?
REMETTRE EN CAUSE LE SYSTÈME
Un souvenir personnel de l’auteur offre une perspective sur la culture antérieure, où le plagiat était souvent toléré sous prétexte de réutilisation légitime du savoir existant.
Il est plus facile de repérer le plagiat que la mauvaise science.
Les pratiques de recherche évoluent, mais avec elles viennent des préoccupations quant à l’exactitude des critères utilisés pour juger de la validité scientifique. La perception du plagiat pourrait nécessiter un réexamen, tout comme les approches contemporaines qui peuvent reconsidérer la valeur du travail collectif versus l’individualisme en recherche.
* * *
Auteur : Anthony Laurent / Sciences Critiques
Date de publication : 2025-07-23 15:12:00
Auteur : Cédric Balcon-Hermand – Consulter sa biographie, ses projets et son travail. Cet article a été vérifié, recoupé, reformulé et enrichi selon la ligne éditoriale Artia13, sans reprise d’éléments protégés.
Application officielle :
Téléchargez Artia13 Actualité sur Google Play
Retrouvez également tous nos contenus sur artia13.city
Notre IA contre la désinformation :
Analyzer Fake News – GPT spécialisé conçu par Artia13
Article rédigé, reformulé et vérifié par Cédric Balcon-Hermand selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : lutte contre la désinformation, respect du droit d’auteur, éthique de l’information et autonomie intellectuelle.